anais
le bulletin de
l' information scientifique
de l’ association
nantes atlantique
pour l’ information scientifique
(anais – afis)
PERIODIQUE A PERIODICITE VARIABLE
N° 17 – SEPTEMBRE 2005
intrusions
spiritualistes et impostures intellectuelles dans les Sciences
 Mardi 11 Octobre 2005 – 20h00 -
Mardi 11 Octobre 2005 – 20h00 -
Muséum d’Histoire Naturelle, Nantes
une conférence de Marc Silberstein et Guillaume Lecointre
organisée par l’association Nantes
atlantique pour l’information scientifique,
la section départementale de
l’union rationaliste et
le groupe de Nantes de la Libre
Pensée.
Marc Silberstein est épistémologue (sciences de l’évolution),
administrateur
des éditions Syllepse et
animateur de
la collection "Matériologiques".
Guillaume Lecointre est chercheur,
Professeur au Muséum
National d'Histoire Naturelle,
spécialiste de
la classification phylogénétique du vivant.
Cette manifestation s’adresse à un public
qui s'intéresse aux sciences sans pour autant avoir bénéficié d'une formation
scientifique approfondie.
 Mardi 11
Octobre 2005 – 17h00 -
Mardi 11
Octobre 2005 – 17h00 -
Forum de la FNAC -
NANTES
une rencontre avec Marc Silberstein
autour des ouvrages édités par les éditions SYLLEPSE
Intrusions spiritualistes et impostures intellectuelles
en sciences
(2001)
Les
matérialismes (et leurs détracteurs) (2004)
l’éditorial
Vous
avez dit « intrusions spiritualistes dans les sciences » ?


 Décidemment,
il n’y a pas que les malheurs de Jean-Pierre et Nathalie, ni ceux de Nicolas et
Cecilia qui sont censés passionner les françaises et les français pendant leurs
vacances. Passons la parole à Pablo Servigne du Monde Libertaire : « DIEU REVIENT EN FORCE. On ne compte plus les couvertures de
magazines qui en parlent. Phrases choc, remises en question infondées, provocations,
confusions, effets d’annonce, la presse people scientifique s’en donne à cœur
joie : « Dieu et la science, le nouveau choc ? » Choc ou
réconciliation ? Car enfin « les scientifiques redécouvrent
dieu », il était grand temps ! Qu’est-ce qu’ils sont vieux jeu ces
gens là ! Ah, ma p’tite dame, m’en parlez pas,
moi ils me font peur. Et puis ils disent souvent des bêtises. « Darwin
avait-il raison ? » Je ne sais pas … peut-être … je ne sais plus
rien. Au fond, la religion est peut-être nécessaire. Inévitable même :
« Sommes-nous programmés pour croire ? » Grâce au « gène de
dieu », pourrons-nous enfin « réenchanter
le monde » ? En attendant, n’hésitez pas à acheter le comparatif
« Dieu, la science et la religion » et découvrir en avant-première
(le terrible choc !) les « révélations sur les manuscrits de la mer
Morte » (numéro du 14 au 20 avril 2005, reproduit sur le site de l’ASSOMAT : http://jerome-segal.de/Assomat/LeMondeLibertaire14-20-4-05(1).jpg
et http://jerome-segal.de/Assomat/LeMondeLibertaire14-20-4-05(2).jpg )
Décidemment,
il n’y a pas que les malheurs de Jean-Pierre et Nathalie, ni ceux de Nicolas et
Cecilia qui sont censés passionner les françaises et les français pendant leurs
vacances. Passons la parole à Pablo Servigne du Monde Libertaire : « DIEU REVIENT EN FORCE. On ne compte plus les couvertures de
magazines qui en parlent. Phrases choc, remises en question infondées, provocations,
confusions, effets d’annonce, la presse people scientifique s’en donne à cœur
joie : « Dieu et la science, le nouveau choc ? » Choc ou
réconciliation ? Car enfin « les scientifiques redécouvrent
dieu », il était grand temps ! Qu’est-ce qu’ils sont vieux jeu ces
gens là ! Ah, ma p’tite dame, m’en parlez pas,
moi ils me font peur. Et puis ils disent souvent des bêtises. « Darwin
avait-il raison ? » Je ne sais pas … peut-être … je ne sais plus
rien. Au fond, la religion est peut-être nécessaire. Inévitable même :
« Sommes-nous programmés pour croire ? » Grâce au « gène de
dieu », pourrons-nous enfin « réenchanter
le monde » ? En attendant, n’hésitez pas à acheter le comparatif
« Dieu, la science et la religion » et découvrir en avant-première
(le terrible choc !) les « révélations sur les manuscrits de la mer
Morte » (numéro du 14 au 20 avril 2005, reproduit sur le site de l’ASSOMAT : http://jerome-segal.de/Assomat/LeMondeLibertaire14-20-4-05(1).jpg
et http://jerome-segal.de/Assomat/LeMondeLibertaire14-20-4-05(2).jpg )
A voir alignées comme cela ces trois couvertures, une première
réaction (saine) est la désolation mais nous savons tous que ces revues
nous renvoient l’image miroir de nos propres sociétés, même si elles
participent à la dynamique d’ensemble. D’aucuns se sont émus en découvrant la
couverture de Science et Vie (la première à être sortie) mais celles et ceux qui ont
suivi, ne serait-ce que dans ce bulletin, l’actualité de l’anthropologie des
religions (les travaux de Pascal Boyer et Scott Atran
évoqués dans de précédents bulletins), celle des sciences cognitives, comme
celle de la biologie ou de la génétique, pouvaient imaginer les authentiques
travaux scientifiques qui serviraient de base aux développements
journalistiques (sachant, qui plus est, que les titres et sous-titres ne sont
le plus souvent pas de la responsabilité du journaliste qui a écrit la revue
mais rajoutés pour susciter les envies d’achat puis de lecture).
Ces revues arrivent donc à point nommé pour illustrer la
vigilance dont nous devons faire part, particulièrement aux frontières de la
connaissance, dans la lecture de tout ouvrage de vulgarisation. La
vulgarisation scientifique est un art difficile, et rendu plus délicat encore
quand se rajoutent, comme pour ces revues, les contraintes mercantiles (attirer
des lecteurs, ne pas en effaroucher) pour assurer la survie souvent difficile
des périodiques.
Il convient donc de bien établir ce qui est du domaine de la
connaissance objective, et ce qui est du domaine de la connaissance subjective.
Gageons que la conférence du 11 octobre aidera à clarifier et à dépister les
intrusions spiritualistes (religieuses ou non explicitement religieuses) dans
les sciences, et ce sans parler des impostures intellectuelles (au sens de Sokal et Bricmont).
Sachons aussi être vigilants, et peut-être l‘aborderons nous dans
le débat, aux propres biais idéologiques qui menacent aussi le « camp
matérialiste », et semblent apparaître quelques fois aux détours de
quelques controverses, là encore aux frontières de la connaissance ; en
effet il convient de garder en mémoire qu’il fut par exemple un temps pas si
lointain où une prétendue « science prolétarienne » entendait dire
aux généticiens ce qu'il fallait penser de la génétique, ou aux biologistes ce qu’il fallait penser de
la biologie, de même qu’elle avait une fâcheuse tendance à penser que la toute
nouvelle physique quantique semblait bien peu soluble dans un certain
matérialisme dialectique … Les partisans du matérialisme philosophique
eux-mêmes ne sont donc pas à l’abri de tels écarts, et c’est bien une
application rigoureuse de la méthode scientifique qui seule permet
d’appréhender le réel avec un minimum de fiabilité.
Michel NAUD, coordinateur de l’association Nantes atlantique
pour l’information scientifique
le 20 septembre 2005
sommaire
les sciences et techniques
Développement
durable
l’énergie électronucléaire au secours de la planète
Développement
durable
le manifeste
« sauvons le climat »
Biotechnologie
Première carte
complète du génome du riz (37 544 gènes)
Génétique des populations
quand les gènes révèlent les règles sociales
Les sociétés matrilocales s’avèrent plus ouvertes à
l’immigration
Biotechnologie
Des organes de porc génétiquement modifiés pour la
transplantation
Site Internet suisse «l’ABC des gènes»
balade
virtuelle dans le patrimoine héréditaire humain
Le génome du Chimpanzé est séquencé
séquence ADN identique à 99 % pour les gènes codants,
(à
96 % en réintégrant l’ADN non codant)
Des vers parasitent les sauterelles
et les poussent à se suicider
les croyances et
pseudosciences
Dossier Science et Vie : notre cerveau est-il programmé
pour croire ?
un message de Daniel
Baril envoyé sur le réseau des brights du Québec
Différence intersexe et religion : une interprétation évolutionniste
par Daniel Baril,
anthropologue des religions
La
prestigieuse revue médicale britannique The Lancet dénonce
l’homéopathie
Echec de l'homéopathie en 5 questions
par Pascal Lapointe, rédacteur en chef de l’Agence Science
Presse (Québec)
Traitement de
l’autisme : jugeant les méthodes psychanalytiques obsolètes
quatre associations de famille saisissent le Comité consultatif
national d'éthique
un article de Jean Yves NAU, journaliste scientifique au
Monde
PRO-CHOICE vs
PRO-LIFE ( pro-choix contre pro-vie)
La souffrance
fœtale au centre de la controverse sur l’avortement aux Etats-Unis
Le Journal of the American Medical
Association plonge dans la
bataille :
Il n’est pas
fondé de parler de souffrance fœtale avant la 30e de semaine de
grossesse
souvenirs
Tchernobyl : l’ampleur réelle de l’accident, un communiqué de l’
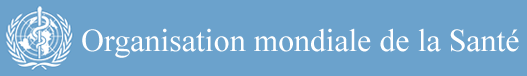
.
forum du nouvel observateur
10 mai
2005
Louis-Marie
HOUDEBINE, directeur de recherches de
l’INRA
membre du comité scientifique de l’AFIS,
est invité sur le forum internet du
Nouvel Observateur
pour dialoguer avec les internautes de
la questions des OGM
http://www.nouvelobs.com/forum/archives/forum_307.html
POUR le progrès
scientifique et technique CONTRE les marchands de
fausses sciences
rejoignez l’ association française pour
l’information scientifique AFIS
adhérer : OUI,
je souhaite adhérer à l’association française pour l’information scientifique
adhésion annuelle : 15,00 euros
abonnement à la revue Science et pseudo-sciences : 22,00 euros ( un an = 5
numéros )
adhésion annuelle + abonnement à la
revue Science et pseudo-sciences ( 5 numéros) : 37,00
euros
siège :14, rue de l’école
polytechnique, 75005 Paris, site
internet national : http://www.pseudo-sciences.org
anais association nantes atlantique pour l’information scientifique
comité régional
de l’ouest atlantique (de bordeaux à la bretagne) de
l’AFIS ; adresser toute correspondance à :
ouest
management, domaine d’activités Nantes Atlantique, rue rené fonck,
44860 Saint Aignan de Grand Lieu,
site internet
du comité régional ouest atlantique : http://afis44.free.fr/index.htm
coordinateur :
Michel NAUD, ingénieur, adresse électronique : afis44@free.fr
les sciences et techniques
Développement
durable
l’énergie électronucléaire au secours de la planète
dans le courrier des lecteurs du Monde du 8
septembre 2005
Dans le
Monde daté du 30 août, Stéphane Lhomme conteste
l'intérêt du nucléaire face à la crise pétrolière. Cela ne surprend pas de la
part du porte-parole du réseau Sortir du Nucléaire. Les arguments mis en avant
laissent cependant pantois.
Le
nucléaire français ne représenterait, selon Stéphane Lhomme,
que 17 % de l'énergie consommée dans notre pays ; c'est exact lorsqu'on
considère que les consommations de 1 kWh de chaleur et de 1 kWh
d'électricité sont strictement équivalentes, ce qui correspond à une des
conventions adoptées internationalement pour comparer des énergies de natures
différentes. Mais il n’y a pas une mais trois conventions
"internationales", dont le choix dépend de l’usage que l’on veut en
faire :
Ø une seconde permet de comparer les
énergies primaires - celles effectivement utilisées pour produire l'électricité
ou le carburant automobile par exemple - ; elle est pertinente lorsqu’on
s’intéresse aux émissions de CO2 ou aux quantités de pétrole consommées
Ø et une troisième permet de comparer
les énergies dites « utiles », par exemple les énergies mécaniques sur
les arbres moteurs de machines thermiques et électriques ; elle est
pertinente lorsqu’on s’intéresse avant tout aux efficacités énergétiques.
Avec ces deux dernières conventions - également utilisées
et reconnues internationalement -, l'électricité nucléaire française représente
bien 40 à 50 % du total de notre énergie, et l'électricité nucléaire mondiale
20 % de l'électricité.
Consciemment ou non, je l’ignore, Stéphane Lhomme a bien évidemment choisi la moins pertinente des
trois conventions internationales pour parler de l’électricité comme moyen de
remplacer – partiellement – le pétrole. Suivons en effet un moment sa
logique : l'électricité mondiale, en utilisant la même convention que lui,
représente environ 12 % de l'énergie consommée dans le monde : une
broutille ! Dès lors, pourquoi se fatiguer à la produire par d'autres moyens
que les combustibles fossiles ? Arrêtons tout de suite de construire des
centrales nucléaires et des éoliennes, et ne gaspillons pas nos ressources à
financer des recherches sur le photovoltaïque ou sur la fusion nucléaire !
En
revanche, lorsqu'on s'intéresse au remplacement du pétrole et à la protection
du climat - et donc au CO2 produit et relâché dans l'atmosphère - force est de
s'intéresser à l'énergie primaire utilisée pour produire l’électricité ; soit,
au niveau mondial, près du 1/3 de l'énergie totale (1). La production mondiale
d'électricité est donc bien responsable d'une fraction notable des rejets de
CO2 (plus de 20%); elle le serait encore plus sans le nucléaire (et
l'hydraulique). Ce n'est pas un hasard si les rejets de CO2 par habitant sont
plus de 1/3 plus faibles en France et en Suède qu'au Danemark et en Allemagne,
c’est bien grâce au nucléaire et à l'hydraulique.
Certes,
l'électricité ne peut pas tout faire, en tout cas tant qu'elle jouera un rôle
marginal dans les transports. Son développement - nucléaire et renouvelable -
se justifie par sa contribution à la maîtrise
de l'effet de serre et - en ce qui concerne le nucléaire - par son
faible coût (n'en déplaise à Stéphane Lhomme). Ce
n'est déjà pas si mal ! Mais il faut aussi travailler d'arrache-pied pour mieux
utiliser l'énergie, élargir les domaines d'utilisation de l'électricité, et
développer les énergies de substitution au pétrole.
Il est temps
que cessent ces petits jeux puérils alors que la planète est en danger. Il est
plus que temps de tout mettre en œuvre pour sauver le climat.

 le courrier des lecteurs du Monde du
8 septembre
le courrier des lecteurs du Monde du
8 septembre
Pierre Bacher
Auteur de
"Quelle énergie pour demain ?" (2000)
mention
spéciale du Prix Roberval, Grand prix 2000
Co-auteur
de « L’énergie de demain » (2005)
Membre du
conseil scientifique du collectif « Sauvons le climat »
(1) Les
combustibles fossiles, en majorité le charbon, produisent près de 60 % de l'électricité
(10% en France), le nucléaire et l'hydraulique chacun 20% (respectivement 75 et
15% en France) et toutes les autres énergies renouvelables confondues moins de 1%.
 Ce texte peut être consulté sur le dossier « les rationalistes
s’expriment »
Ce texte peut être consulté sur le dossier « les rationalistes
s’expriment »
mais en ligne sur le site internet
national de l’union rationaliste
http://www.union-rationaliste.org/
Développement
durable
le manifeste
« Sauvons le Climat »
La concentration des gaz à effet de serre dans
l'atmosphère de notre planète atteint aujourd'hui un niveau supérieur à tout ce
qu'elle a connu depuis plus d'un demi million d'années. Démarrée au début de
l'ère industrielle, vers les années 1880, cette hausse est essentiellement due
à l'accumulation des émissions croissantes de gaz carbonique et de méthane
résultant de l'activité humaine. Si nous ne faisons rien, cette hausse va se
poursuivre.
En très grande majorité les experts qui observent et
étudient ces phénomènes sont formels : sauf à réduire les émissions, notamment
celles de gaz carbonique, d'un facteur au moins égal à 2, notre globe verra sa
température moyenne augmenter de plusieurs degrés au cours du présent siècle.
Une telle augmentation de température, comparable en ordre de grandeur à celles
qui ont suivi les périodes glaciaires, mais qui se produira de façon beaucoup
plus rapide, aura des conséquences majeures sur le climat. Les conséquences qui
en résulteraient sur notre santé, la végétation et les productions agricoles,
le niveau des mers, les espèces vivantes, etc. sont évidemment plus difficiles
à cerner mais nul ne peut exclure que des évolutions irréversibles
catastrophiques, allant jusqu'à mettre en cause les conditions de vie de
l'espèce humaine, puissent se produire. Qu'attendons nous, face au
réchauffement climatique qui nous menace, pour mettre en oeuvre le principe de
précaution ? Il nous faut limiter les émissions de gaz à effet de serre par
tous les moyens à notre disposition.
Si des économies d'énergie importantes sont
possibles et souhaitables dans les pays développés, il est impossible d'exiger
des efforts similaires de la part des pays en voie de développement. Sauf
récession économique catastrophique la consommation énergétique mondiale va
continuer à croître. Il est donc capital de mettre en oeuvre, chaque fois que
cela est possible, des techniques de production d'énergie ne faisant pas appel
aux combustibles fossiles. De telles techniques existent dans le domaine de la
production d'électricité pour les réseaux centralisés: énergie nucléaire,
hydroélectricité, éolien. Le solaire photovoltaïque est particulièrement bien
adapté aux sites isolés et aux pays dont le réseau de distribution électrique
est peu développé. Le solaire thermique, la géothermie, la biomasse bien gérée,
les pompes à chaleur doivent prendre davantage de place pour le chauffage des
locaux et la production d'eau chaude. Les transports demeureront encore
longtemps les plus tributaires des combustibles fossiles ; il n'en est que plus
important de rechercher d'autres solutions: développement des transports en
commun, véhicules électriques, utilisation de l'hydrogène produit par
électrolyse ou décomposition thermochimique de l'eau.
Face aux grands pays en émergence qui vont, par
nécessité et comme nous l'avons fait au cours des deux siècles passés, fonder
leur développement sur le charbon et le pétrole, et donc (sauf aboutissement,
bien difficile à prévoir, des études en cours sur la séquestration du gaz carbonique)
voir croître leurs rejets de gaz carbonique, les pays développés doivent
démontrer que la limitation des émissions de gaz à effet de serre grâce aux
technologies modernes est possible, sans handicap économique majeur et sans
diminution de qualité de vie. La France (qui, grâce au nucléaire, a déjà une
position enviée, avec des émissions de 6 tonnes de gaz carbonique par tête et
par an, contre 10 en Allemagne et 20 aux USA) doit continuer à montrer
l'exemple.
Il est temps que les Français se convainquent que
l'objet du débat énergétique n'est pas de savoir s'il faut ou non "sortir
du nucléaire", mais plutôt de savoir comment "limiter le plus
possible l’utilisation des combustibles fossiles" qui menace notre climat.
Le nucléaire, maîtrisé comme il l'est dans nos pays, présente des risques
minimes comparés à ceux des gaz à effet de serre et s'il serait irréaliste de
vouloir "sortir des combustibles fossiles" il serait totalement
irresponsable de s'en tenir au statu-quo.
Nous appelons nos concitoyens et nos dirigeants à
engager une politique volontariste et décidée, à la fois d'économies d'énergie
et de développement de l'énergie nucléaire et des énergies renouvelables. Une
telle politique est la seule qui puisse raisonnablement garantir à notre
génération et aux générations futures le maintien de conditions climatiques
acceptables et prévisibles.
signer ce manifeste : http://gasnnt.free.fr/sauvonsleclimat/signataires-extrait.html
Le
collectif "Sauvons le Climat"
est constitué des signataires du manifeste « Sauvons le Climat ». Ce
collectif est soutenu l'ARCEA (Associations des
retraités du CEA), l'AEPN (Association des
Ecologistes Pour le Nucléaire), le GR21 (Groupe d'études sur l'énergie et
l'environnement au 21ème siècle et la SFP (Société Française de Physique). Il
se donne pour ambition de donner une information scientifiquement fondée et
aussi objective que possible sur le réchauffement climatique et les questions
énergétiques en général et de faciliter les échanges et discussions entre ses
membres. Son Président actuel est Michel
PETIT, docteur
es Sciences, Ingénieur de l’Ecole Polytechnique et de l’Ecole Nationale
Supérieure des Télécommunications, vice-président du comité de l’environnement
de l’Académie des Sciences et vice-président de l’Union Rationaliste.


Biotechnologie
première carte
complète du génome du riz (37 544 gènes)
Le riz représente 20% de l'alimentation
mondiale et est la principale source nutritive de plus de 3 milliards d'êtres
humains. La croissance démographique dans les pays en développement et les
tendances observées au niveau de la consommation laissent supposer que le riz
jouera un rôle de plus en plus prépondérant, avec 4,6 milliards de personnes
qui en devraient en dépendre d'ici 2025. Pour faire face à la demande, la
production de riz devra enregistrer une hausse d'environ 30%. De plus, le
réchauffement climatique pourrait nécessiter, à l'avenir, un riz plus résistant
à la sécheresse.
Le Projet international de séquençage du génome du riz (IRGSP) a été fondé en
1997 pour obtenir cette séquence cartographiée très précise du génome du riz.
Dirigé par le Japon, il compte neuf autres membres à l'heure actuelle : les
États-Unis, la Chine, Taiwan, la Corée, l'Inde, la Thaïlande, la France, le
Brésil et le Royaume-Uni.
Les 37.544 gènes du riz ont pu être identifiés et positionnés sur les 12
chromosomes.
"Il s'agit d'une avancée majeure, non
seulement pour la science et l'agriculture, mais également pour tous ceux pour
qui le riz constitue l'aliment de base", déclare Joachim Messing, coauteur de l'étude publiée dans le magazine
Nature.
En effet, cette réalisation devrait
permettre aux agriculteurs, par la mise en oeuvre des biotechnologies,
d'accroître la production de riz, de protéger les cultures contre les maladies
et les ravageurs et de rendre le riz résistant à la sécheresse.
En outre, le riz se rapprochant, sur le plan
génétique, du maïs, du blé, de l'orge, du seigle, du sorgho et de la canne à
sucre sur le plan génétique, l’achèvement de cette cartographie pourrait
également contribuer à percer les secrets d'autres cultures vivrières
cruciales.
 http://www.futura-sciences.com/news-premiere-carte-complete-genome-riz_6939.php
http://www.futura-sciences.com/news-premiere-carte-complete-genome-riz_6939.php
Génétique des populations
quand les gènes révèlent les règles sociales
Les sociétés matrilocales s’avèrent plus ouvertes à
l’immigration
Sur la durée,
l’organisation sociale d’une population humaine influence fortement sa
diversité génétique. Les scientifiques peuvent dès lors utiliser des
informations génétiques pour étudier des structures sociales. Dans une étude
soutenue par le Fonds national suisse, des chercheurs bernois ont, pour la
première fois, pu déterminer les différences entre taux d’immigration masculine
et féminine dans différentes populations de Thaïlande.
Les sociétés patrilocales (où l’épouse s’installe dans le village de son
époux) contrôlent beaucoup plus strictement l’immigration masculine que les
sociétés matrilocales (où les maris suivent leur femme après le mariage). Ce
résultat résulte d’une analyse génétique menée sur une demi-douzaine de
populations vivant au nord de la Thaïlande dans la région du Triangle d’Or.
Laurent Excoffier, professeur de génétique des
populations à l’Institut de zoologie de l’Université de Berne, a pu démontrer
que les hommes sont huit fois moins nombreux à immigrer dans les sociétés
patrilocales que dans les sociétés matrilocales. Dans son article, paru
récemment dans la revue Proceedings of the National Academy of
Sciences*, il ajoute que les femmes sont, au contraire, 2,5 fois plus
nombreuses à immigrer dans les sociétés patrilocales que dans les matrilocales.
L’étude montre aussi que moins d’un homme par génération intègre une
population patrilocale, alors que cette intégration est 16 fois plus fréquente
dans le cas des femmes. Cette situation contraste fortement avec celle
prévalant dans les sociétés matrilocales où les hommes et les femmes
s’intègrent dans des taux similaires. Ces chiffres correspondent d’ailleurs aux
observations ethnologiques dans cette région, qui montrent que les populations
patrilocales adoptent en général des règles sociales d’immigration beaucoup
plus strictes que les populations matrilocales.
Du point de vue technique, la migration féminine a été déterminée par
l’analyse de la diversité génétique de l’ADN des mitochondries. Ces petites
organelles, «centrales énergétiques» des cellules, se transmettent seulement
par la mère. Quant à la composante masculine, elle a été étudiée via les gènes
se trouvant sur le chromosome Y. Six populations ont été étudiées, dont trois
matrilocales et trois patrilocales.
Les chercheurs ont analysé un certain nombre de sites (locus) sur ces
gènes et mesuré la fréquence des différentes versions (allèles) de ces gènes.
Comme l’on connaît le taux naturel de mutation des mitochondries et du
chromosome Y, il est possible de déduire de ces données le passé démographique
d’une population. Laurent Excoffier s’est servi d’un
outil statistique récemment développé par son équipe dans le cadre d’une
recherche soutenue par le Fonds national suisse. Cette méthode de calcul
permet, par simulations informatiques, d’estimer des paramètres comme le taux
d’immigration ou la période à laquelle la population a commencé son expansion.
Les résultats sur les migrations résultent donc uniquement d’échantillons
prélevés dans le groupe d’individus étudié, contrairement aux modèles
classiques d’analyse en génétique des populations qui nécessitaient de tenir
compte des groupes de population voisins.
Une minorité de sociétés matrilocales
Le nord de la Thaïlande présente des conditions idéales pour ce type
d’études : on y trouve à la fois des sociétés patrilocales et matrilocales, ces
dernières étant très minoritaires dans le monde. Les conditions climatiques et
environnementales y sont très similaires pour toutes les populations étudiées,
tout comme le mode de vie (paysans sédentaires). Cette situation limite les
facteurs pouvant entraîner des différences génétiques.
«Les données génétiques utilisées ont été récoltées et analysées une
première fois par des chercheurs allemands, précise Laurent Excoffier.
Celle-ci avait déjà observé que la diversité des marqueurs spécifiques aux
hommes (sur le chromosome Y) était plus faible dans les populations
patrilocales que matrilocales. Mais cela restait une appréciation générale, et
notre équipe a pu quantifier ce phénomène et, en plus, comparer le niveau de
migrations féminines et masculines dans le même type de société.»
Cette nouvelle méthode statistique peut s’appliquer à d’autres espèces
que l’être humain. Elle permet d’obtenir des informations sur le système de
reproduction d’une population animale quelconque, son taux de migration ou
encore son histoire démographique (expansion, contraction, etc.). Les
chercheurs bernois travaillent en particulier sur la diversité génétique des
poissons d’eau douce en Suisse, afin de retracer l’histoire de la
recolonisation des rivières et des lacs après la dernière période glaciaire.
«On peut se faire de fausses idées sur les capacités d’expansion de certaines
espèces animales dans les conditions environnementales actuelles, qui sont très
influencées par les activités humaines, note Laurent Excoffier.
Elles étaient peut-être très différentes dans le passé !» De telles
informations sont importantes car elles permettent de mieux comprendre
l’écologie d’espèces en danger d’extinction.
* Proceedings of the National
![]() http://www.snf.ch/fr/com/prr/prr_arh_05aug22.asp
http://www.snf.ch/fr/com/prr/prr_arh_05aug22.asp
Biotechnologie
des organes de porc génétiquement
modifiés pour la transplantation
La greffe est pour
beaucoup de maladies terminales des organes le seul moyen de survie. Cependant,
il n'y a mondialement pas assez de donneurs d'organe. Une alternative est la
xénogreffe, c'est-à-dire l'utilisation d'organes et de tissus animaux pour
sauver des patients humains.
Pour toutes les greffes mais en particulier pour ce type de greffe, les réactions
immunitaires sont à redouter. "La greffe d'organe de porc chez les
primates provoquant une cascade complexe de mécanismes de rejets",
rapporte le Prof. Dr. Wolf, "on ne pourra surmonter ce phénomène à long
terme que grâce à une modification génétique des porcs donneurs".
L'équipe du Prof. Dr. Eckhard Wolf et du Dr. Regina Klose à Munich est parvenue à élever un porc TRAIL
génétiquement modifié dont les organes sont à priori à l'abri des défenses
immunitaires humaines. Ce porc TRAIL présente comme marqueur à la surface de
ses cellules la protéine humaine "TNF alpha-related
apoptosis-inducing ligand". Elles sont ainsi
protégées in vitro contre les cellules du système immunitaire humain. Des
études supplémentaires devront montrer si ce mécanisme fonctionne également
dans des animaux vivants. Il faudra sûrement pour cela combiner différentes
modifications génétiques des porcs donneurs.
 http://www.futura-sciences.com/news-organes-porc-genetiquement-modifies-transplantation_6842.php
http://www.futura-sciences.com/news-organes-porc-genetiquement-modifies-transplantation_6842.php
Site Internet suisse «l’ABC des gènes»
balade
virtuelle dans le patrimoine héréditaire humain
Le site Internet «l’ABC des gènes» a été
complété d’une nouvelle rubrique "Nos gènes", qui permet
un voyage virtuel à la découverte du patrimoine héréditaire de l’être humain. A
l’aide de nombreux exemples et animations, solidement documentés et empruntés à
la génétique, les visiteurs peuvent comprendre comment fonctionnent nos gènes,
quelle est leur interaction avec notre environnement et ce qui fait ce que nous
sommes
Des phénomènes quotidiens comme la sensation de faim, le stress avant un
examen ou le vieillissement sont influencés par nos
gènes. Si cette influence est parfois très directe, elle s’exprime dans la
plupart des cas via des mécanismes biologiques très complexes. Notre patrimoine
héréditaire est aujourd’hui entièrement décodé, et la science comprend toujours
mieux l’interaction entre nos gènes et l’environnement. La nouvelle rubrique
"Nos gènes" du site gene-abc.ch cherche précisément à expliquer ces
phénomènes et les acquis récents de la recherche sur les génomes.
La rubrique "Nos gènes" du site vise à ce que les
connaissances sur les gènes, qui s’étoffent rapidement, soient accessibles au
large public. Des animations graphiques le permettent : Fanny et Jimmy, les
deux enfants malicieux de l’ABC des gènes, nous font
visiter de façon amusante et compétente le patrimoine génétique, d’un
chromosome à l’autre. Sans perdre le lien avec la vie quotidienne, ils
expliquent comment fonctionnent ces interactions complexes ou jettent un coup
d’oeil dans la préhistoire de l’être humain : Pourquoi certains adultes ne
supportent-ils pas les produits laitiers ? Comment un gène peut-il être
responsable de quatre groupes sanguins ? Le stress rend-il vraiment malade ? Y-a-t-il un gène de l’intelligence ? Treize exemples
solidement documentés expliquent qu’il faut chercher aussi bien dans nos gènes
que dans l’environnement la réponse à de nombreuses questions.
Le site www.gene-abc.ch est né de l’initiative de la Division
"Biologie et médecine" du Fonds national suisse de la recherche
scientifique. Le FNS désire ainsi renforcer le dialogue autour de la biologie
moderne et mettre à disposition du public dans la forme adéquate des
connaissances de base. L’ABC des gènes ne s’adresse pas seulement aux écoliers,
mais aussi au personnel enseignant et aux adultes. Le nombre d’utilisateurs,
qui est en constante augmentation, montre que ce portail en trois langues est
devenu une source d’information incontournable dans ce domaine, pour tous
celles et ceux qui ont une soif d’apprendre, en Suisse mais aussi dans les pays
limitrophes. Le contenu de l’ABC des gènes est
régulièrement examiné par des scientifiques et réactualisé, pour lui assurer
une qualité optimale.
![]() http://www.gene-abc.ch/welt/index_f.html
http://www.gene-abc.ch/welt/index_f.html
Le génome du Chimpanzé est séquencé
séquence ADN identique à 99 % pour les gènes codants,
(à
96 % en réintégrant l’ADN non codant)
note
lexicale : le
génome représente l'ensemble des gènes
(étendu par abus de langage aux séquences non codantes) d'un individu : il
s’agit ainsi de son « patrimoine héréditaire ». Le code génétique est le code utilisé par
la cellule pour traduire l'ADN en
protéine, c'est à dire passer des codons
(séquences de trois bases nucléotides consécutives portées par l’ARN messager) aux
acides aminés. Le code génétique est quasi universel pour l'ensemble des espèces
connues, à l'exception semble-t-il de deux organismes, dont une levure, pour
lesquels deux codons sont modifiés. (merci à NB de l’INSERM pour son aide – il se
reconnaîtra -)
Le
chimpanzé est le premier primate dont le génome a fait l'objet d'un séquençage.
De
futurs travaux de recherche seront axés sur la signification des différences.
L'étude a été réalisée par le Chimpanzee Sequencing and Analysis Consortium, composé de 67 scientifiques
représentant 23 instituts de recherche des Etats-Unis, d'Allemagne, d'Italie,
d'Israël et d'Espagne.
Les
résultats ont été publiés dans la revue Nature.
Les
travaux fournissent un inventaire des différences génétiques apparues depuis
que les humains et les chimpanzés ont commencé à se distinguer d'un ancêtre
commun il y a quelque six millions d'années. Ces données, et toutes les données
que le consortium définira à l'avenir, sont placées dans le domaine public, ce
qui signifie que les scientifiques du monde entier peuvent
contribuer aux travaux.
Les études moléculaires modernes qui ont permis d’établir que, sur le plan
évolutif, le chimpanzé commun (Pan troglodytes) et le bonobo
(Pan paniscus ou chimpanzé nain) sont les plus
proches parents vivants des humains.
Les chimpanzés sont par conséquent particulièrement bien placés pour nous aider
à mieux nous connaître, non seulement en raison de leurs ressemblances avec les
humains, mais également des différences qui constituent nos caractéristiques
spécifiquement humaines, notamment la bipédie habituelle, l'utilisation
d'outils, un cerveau de très grande taille et un langage complexe.
D'importantes ressemblances et différences ont également été constatées au
niveau de l'incidence et de la gravité de plusieurs grandes maladies de
l'homme. La comparaison des génomes de l'homme et du chimpanzé peut contribuer
à révéler la base moléculaire de ces caractéristiques ainsi que les forces
évolutives qui ont façonné les espèces, y compris les processus mutationnels
sous-jacents et les contraintes sélectives.
Les génomes du chimpanzé et de l'homme sont "remarquablement similaires et
codent des protéines très semblables". L'étude montre que seul 1,2 pour
cent sépare le corps humain de celui du chimpanzé en termes de gènes codant
pour les protéines qui le fabriquent et l'entretiennent. Cette différence passe
à environ 4 pour cent lorsque l'ADN non codant (ajouts
et suppressions d'ADN) est pris en compte.
Les chercheurs expliquent qu'au cours de l'évolution, les humains et les
chimpanzés ont accumulé dans leurs génomes plus de mutations potentiellement
délétères que les souris, les rats et d'autres rongeurs. Si de telles mutations
peuvent être la cause de maladies, affectant la condition physique générale
d'une espèce, les scientifiques estiment qu'elles sont peut-être aussi à
l'origine de la capacité des primates à s'adapter aux changements
environnementaux rapides et qu'elles leur ont permis d'atteindre un degré
d'adaptation évolutionnaire unique.
Au cours des quelques prochaines années, cette comparaison devrait aider à
mieux comprendre comment le génome humain a évolué et pourquoi les humains sont
frappés par le cancer et d'autres maladies qui n'affectent que très rarement
les chimpanzés.
 http://www.futura-sciences.com/news-chimpanzes-humains-si-proches-differents_7121.php
http://www.futura-sciences.com/news-chimpanzes-humains-si-proches-differents_7121.php
 des films
en libre accès, classés par thématique,
des films
en libre accès, classés par thématique,
sur le comportement du chimpanzé
http://www.nature.com/news/specials/chimpgenome/behaviour/index.html
un voyage interactif
http://www.nature.com/news/specials/chimpgenome/interactive/index.html
Des vers parasitent les sauterelles
et les poussent à se suicider
Les chercheurs du laboratoire Génétique
et évolution des maladies infectieuses (CNRS – IRD, Montpellier) étudient une
curieuse association entre un groupe de vers parasites, les nématomorphes,
et leur hôte, les orthoptères (grillons, sauterelles). Quand ils passent du
stade larvaire au stade adulte, ces parasites obligent leur hôte à se «
suicider » en se jetant à l'eau. Les chercheurs viennent de mettre en évidence
le dialogue moléculaire qui s'instaure entre le parasite et son hôte avant,
pendant et après le « suicide » de l'insecte. Ils avancent ainsi dans la
compréhension des phénomènes qui permettent à un parasite de modifier le
comportement de son hôte en agissant sur le fonctionnement du système nerveux.
Ces résultats sont en ligne sur le site des Proceedings
of the Royal Society of London B.
la suite sur :
 http://www2.cnrs.fr/presse/communique/733.htm
http://www2.cnrs.fr/presse/communique/733.htm
Les résultats sont en ligne (en
anglais et payants) sur le site des Proceedings of the Royal Society of London B.
les croyances et
pseudosciences
Dossier Science et Vie : notre cerveau est-il programmé
pour croire ?
un message de Daniel Baril envoyé sur le réseau
des brights du Québec
Je ne partage pas l’idée impressionniste laissée
par le titre accrocheur (Notre cerveau est programmé pour croire) que ne
supporte d’ailleurs pas l’article. J’avais déjà pris connaissance des études
sur lesquels repose cet article, dont celle concernant la sérotonine (équipe de
Borg) et qui date déjà de deux ans. Cette étude a voulu vérifier si la
sérotonine était un marqueur de différents traits de personnalité. Sept
éléments (novelty seeking,
harm avoidance, reward dependance, persistence, self-direction, coopérativeness, transcendence)
ont été mis en corrélation avec le nombre de récepteurs à sérotonine dans trois
régions du cerveau.
La corrélation n’a pu être observée qu’à
l’élément transcendance, et encore dans une seule de ses composantes, soit
l’ouverture à la spiritualité (les deux autres étant transpersonal
identification et self-forgetfull). Plus le
nombre de récepteurs à sérotonine est faible (ce qui entraîne un taux plus
élevé de sérotonine dans le sang), plus l’ouverture à la spiritualité est
forte. L’étude n’a porté que sur 15 hommes (aucune femme) âgés de 20 à 45 ans.
Or d’autres études ont montré une variation intersexe
du taux de sérotonine, et une diminution plus rapide avec l’âge chez les
hommes. Cette diminution n’est pas corrélée par une diminution de religiosité
plus importante chez les hommes; la diminution de religiosité est plus forte
avec l’âge chez les femmes, ce qui attire l’attention du côté de la
testostérone.
Pour compléter ce que Jean-François a déjà dit
sur la sérotonine, ce transmetteur joue un rôle dans la stimulation et
l’excitabilité; plus il est élevé, moins l’excitabilité est forte. La
sérotonine a donc un effet inhibiteur sur la stimulation sensorielle, du moins
chez des modèles animaux. Chez le rat, des modifications d’un gène lié à la
production de sérotonine permettent de créer des individus soit amorphes soit
agressifs. L’agressivité accrue a été associée dans ce cas à un taux d’anxiété
plus élevé. Or on sait qui l’anxiété est un trait de personnalité corrélé avec
une religiosité forte et que la recherche d'excitabilité est corrélée à une
religiosité faible; ces deux éléments expliquent en partie l’écart intersexe dans la religiosité.
Tout ce ceci pour dire que rien ne supporte
l’idée naïve que la corrélation entre sérotonine et religiosité démontre que le
cerveau serait programmé pour croire en Dieu. Selon la même logique, on
pourrait dire que puisqu’un taux élevé de monoamine-oxydase est associé avec un
faible degré de religiosité, le cerveau est donc programmé pour ne pas croire
en Dieu.
Par ailleurs, les travaux de deux des
chercheurs (Boyer et Atran) mentionnés dans l’article
de Science et Vie se situent à l’opposé d’une telle interprétation. Leur
position (qui est aussi celle que j’ai développée dans ma thèse sur la
différence entre hommes et femmes dans la religiosité (voir article ci-dessous et lien sur le site de la Libre
Pensée Québécoise) ; est plutôt de dire que la religion est un épiphénomène
de nos dispositions cognitives adaptées à la vie en société. La corrélation avec
la sérotonine en est une autre illustration.
Quant aux travaux de Newberg
(qui ont fait l’objet de ma conférence aux Sceptiques du Québec en octobre 2002), ils n’ont fait que montrer
l’état d’activation neuronale pendant la prière et la méditation. L’inhibition
artificielle de certains centres qui a alors été observée est en fait un
contre-exemple d’un cerveau préprogrammé pour entrer en relation avec Dieu
puisqu’il faut désactiver des fonctions cérébrales essentielles liées à la
conscience de soi pour vivre ce que les croyants appellent une expérience
mystique.
 Daniel Baril, anthropologue,
journaliste scientifique
Daniel Baril, anthropologue,
journaliste scientifique
au journal Forum de l'Université de
Montréal (www.iforum.umontreal.ca)
et président du Mouvement laïque québécois
(www.mlq.qc.ca)
quelques articles de Daniel Baril :
La
place de la religion... (oct. 1998)
La
laïcité pour nous protéger... (avr.
2003)
Secularism
is an expression of Humanism
(Feb. 2003)
L'affirmation
bright est un geste politique (oct. 2004)
Différence intersexe et religion : une interprétation évolutionniste
par Daniel Baril, anthropologue des
religions,
président du Mouvement Laïque Québecois
Dans toutes les études statistiques sur la religion, les femmes
affichent une plus forte religiosité que les hommes. L’analyse de la
littérature sur le sujet montre pour la première fois que cet écart est
observable dans tous les marqueurs de la religiosité, quelles que soient les
conditions socio-économiques des répondants et quelles que soient les époques.
Ce fait met sur la piste des fondements biosociaux de
la religion.
lire la suite : http://www.libre-pensee.qc.ca/modules.php?name=Content&pa=showpage&pid=48
![]() La
Libre Pensée Québecoise www.libre-pensee.qc.ca
La
Libre Pensée Québecoise www.libre-pensee.qc.ca
La
prestigieuse revue médicale britannique The Lancet dénonce
l’homéopathie
The Lancet en oublie le flegme légendaire
des grands bretons ...
En effet, pour cette publication de référence,
le temps des études supplémentaires est maintenant terminé et The Lancet
estime que désormais les médecins devraient avoir l’honnêteté d’expliquer à
leurs patients qu’ils n’ont pas d’effet bénéfique à attendre de l’homéopathie.
L’étude décisive pour The Lancet est celle conduite par une équipe de
l’institut de médecine sociale et préventive de l’université de Berne (CH), qui
s’est associée avec une équipe de l’université de Zürich (CH) et une autre de
l’université de Bristol (UK).
Cette étude n’était pas une étude de plus
visant à comparer l’efficacité thérapeutique d’un produit homéopathique face à
la prescription en double aveugle d’un placebo ; elle ne visait pas non plus
à inventorier les études relatives à des produits homéopathiques pour réaliser
un énième décompte des conclusions favorables ou défavorables aux homéopathes.
Cette étude est une étude méthodologique
visant à comparer, pour des mêmes pathologies (asthme, allergies, problèmes
musculaires), 110 plans d’essais menés en confrontation de produits
homéopathiques avec des placebos, avec 110 plans d’essais menés en
confrontation de médicaments avec des placebos. Les plans d’essais
sélectionnés, aussi bien ceux relatifs à la médecine scientifique qu’à
l’évaluation de l’homéopathie, étaient de nature variée, en particulier menés à
grande ou petite échelle.
Tant pour les médicaments que pour les
produits homéopathiques, les résultats montrent que les études de faible
échantillonnage et de faible qualité statistique conduisent à surévaluer
l’effet bénéfique du traitement testé comparativement à ce qui se mesure avec
des échantillonnages plus importants.
Dès lors que l’échelle du plan d’essai (la
taille de l’échantillon) est suffisamment importante, les chercheurs n’ont pas
pu mettre en lumière de différence entre les produits homéopathiques et les
placebos.
Le Professeur Matthias Egger déclare : « Nous savons bien qu’il est impossible de prouver
l’inexistence d’un phénomène. Par contre les études de bonne qualité et
réalisées à grande échelle relatives à l’homéopathie ne mettent pas en évidence
de différence avec un traitement par placebo, alors que dans les mêmes
conditions expérimentales vous continuez à mesurer un effet des médecines
conventionnelles ». Reconnaissant que certains patients se sentent mieux après
avoir été traité par homéopathie, il attribue cela à la thérapie elle-même, à
savoir le temps et l’attention que l’homéopathe consacre au patient mais,
dit-il, « cela n’a rien à voir
avec ce qu’il y a dans la petite pilule blanche ».
Ces travaux ont été présentés en septembre à
Chicago lors du congrès international des publications biomédicales à comités
de lecture :
Quality of
Placebo-Controlled Trials of Alternative and Conventional Medicine:
Matched–Pair Study, Dr.
Aijing Shang, Dr Karin Huwiler, Dr. Linda Nartey, Dr. Peter Jüni, and Pr. Matthias Egger , Fifth International
Congress on Peer Review and Biomedical Publication, September 16-18, 2005 ,
Chicago, Illinois http://www.ama-assn.org/public/peer/program.html
![]() http://news.bbc.co.uk/go/pr/fr/-/2/hi/health/4183916.stm
http://news.bbc.co.uk/go/pr/fr/-/2/hi/health/4183916.stm

Echec de l'homéopathie en 5 questions
par Pascal Lapointe, rédacteur en chef de l’Agence Science Presse
(Québec)
Or donc, une étude publiée dans une prestigieuse revue médicale conclut
–une fois de plus– à l'inefficacité de l'homéopathie. Les défenseurs de l'homéopathie
n'ont pas tardé à descendre cette étude en flammes, mais ont-ils des arguments
solides? Regard sur ce débat ramené à cinq questions.
1. Cette étude est-elle pilotée par l'industrie
pharmaceutique?
Non. Le chercheur derrière cette étude, Matthias Egger, du département de médecine sociale et préventive à
l'Université de Berne, en Suisse, était aussi, l'automne dernier, derrière
l'étude faisant état des liens entre le Vioxx et les
maladies cardio-vasculaires, étude qui a accéléré le retrait de ce médicament
des pharmacies.
Qui plus est, toutes les grandes industries ont leurs
lobbyistes, incluant l'industrie pharmaceutique... mais aussi l'industrie de
l'homéopathie. Celle-ci génère des milliards de dollars de revenus chaque année
et elle embauche elle aussi des lobbyistes très efficaces. Leur principale
stratégie consiste non pas à démontrer les mérites de l'homéopathie, mais à
dénigrer la pharmacologie.
2. Si l'industrie pharmaceutique et l'industrie homéopathique défendent chacun leurs
intérêts, comment savoir qui a raison?
La seule et unique méthode valable, c'est la recherche de
preuves statistiques permettant de répondre hors de tout doute à la question
"Est-ce que ça marche?" Tout médicament qui se retrouve sur les
tablettes des pharmacies doit être passé par une batterie de tests –sur des
animaux et des humains– démontrant son efficacité (le processus n'est pas
infaillible, comme le démontre justement le Vioxx,
mais il a amplement démontré son utilité). En revanche, jamais un produit
homéopathique n'a pu faire la preuve qu'il avait une efficacité supérieure à
celle d'un placebo (une fausse pilule que le patient croit être vraie).
3. Pourquoi donc tant de gens prétendent-ils avoir été guéris par
l'homéopathie?
Deux raisons peuvent l'expliquer: premièrement, l'effet
placebo, c'est-à-dire cet impact positif, dûment mesuré par la recherche depuis
des décennies, qu'a sur un patient un médicament, même faux. Deuxièmement,
notre propre corps qui, avec son système immunitaire, dispose de très puissants
mécanismes de défense contre la maladie, mécanismes qui sont encore loin
d'avoir été pleinement élucidés.
À cela, les homéopathes rétorquent que des enfants de
moins de deux ans et des animaux auraient été guéris, eux chez qui l'effet placebo
ne joue certainement pas. Mais les recherches en question sont vagues et peu
convaincantes. Et en absence de suivi médical, rien ne permet de confirmer si
les enfants souffraient vraiment de ce dont on a dit qu'ils souffraient, si ce
n'est pas leur système immunitaire qui était à l'oeuvre ni si, à long terme,
ils ont vraiment été guéris. Le fait que l'industrie homéopathique elle-même
n'ait jamais publié d'études sérieuses en double aveugle sur des milliers
d'animaux, chose qui ne serait pas difficile à organiser, oblige à demeurer
très sceptique.
4. L'étude de la semaine dernière est accusée de s'être appuyée sur des données
incomplètes.
C'est un faux argument puisque, comme l'explique son
chercheur principal, c'est "une étude d'études": son équipe a passé
en revue 110 études majeures comparant divers produits homéopathiques avec des
placebos, et 110 études comparant des médicaments avec des placebos. Dans les
deux cas, pour des maux tels qu'allergies, asthme et problèmes musculaires. Il
en résulte une très large perspective, de loin supérieure à ce qu'aurait
procuré une seule étude portant sur un seul échantillon de patients.
Matthias Egger ne nie pas qu'il
y ait des gens qui se sentent mieux après avoir pris leurs gélules. Mais les
chiffres parlent d'eux-mêmes: "nous n'avons trouvé aucune
différence entre les médecines homéopathiques et les placebos."
"Peut-être l'effet positif est-il dû, dans une
perspective plus large, au fait de rencontrer quelqu'un qui s'intéresse à vous,
qui écoute votre histoire pendant beaucoup plus longtemps que ce que ferait un
médecin. Je ne suis pas surpris que des gens aillent mieux."
Une conclusion
renforcée par un sévère
éditorial publié dans la même édition de la revue britannique The Lancet, qui enjoint
les médecins à dire la vérité à leurs patients.
La dernière ligne de défense des homéopathes, exprimée
en fin de semaine dans le Globe and Mail
par la naturopathe torontoise Ruth Anne Baron, c'est que l'homéopathie
fonctionnerait en réalité lorsqu'on l'adapte à chaque patient, ce qui
empêcherait d'en mesurer un impact global. Mais si tel est le cas, pourquoi
cette immense variété de produits homéopathiques vendus en pharmacie sans
prescription?
5. Est-il exact que l'homéopathie remonte à la nuit des temps?
Non. L'homéopathie est une théorie qui a été forgée de
toutes pièces, sans études cliniques, par l'Allemand Samuel Hahnemann vers
1780. C'est à lui qu'on doit le principe de dilution, qui est la base même de
l'homéopathie: ce principe dit que si vous prenez un produit X, et que vous en
diluez un litre dans 100 litres d'eau, puis que vous prenez un litre du
"mélange" ainsi obtenu et que vous le diluez dans 100 litres d'eau
(deuxième dilution), puis que vous prenez un litre du nouveau mélange et que
vous le diluez dans 100 litres d'eau (troisième dilution), et ainsi de suite
jusqu'à la 7e ou 8e dilution, le produit X n'en sera que plus efficace.
A cette époque, la chimie était encore balbutiante et on
ne connaissait à peu près rien des atomes et des molécules. Son arrêt de mort a
été signé lorsqu'on est devenu capable de littéralement compter le nombre
d'atomes du produit X dans un litre d'eau, constatant du coup qu'il ne peut
plus rester un seul atome du produit initial. L'homéopathie s'est dès lors
retrouvée sans fondements.
Jusqu'à ce qu'au milieu du XXe siècle, soit popularisée
une nouvelle théorie, celle de la mémoire de l'eau: l'eau garderait le souvenir
des molécules avec lesquelles elle a été en contact. Ce fut une résurrection
–même si cette théorie comporte, à sa face même, une faille majeure: toute
goutte d'eau qui se retrouve au fond d'une bouteille est entrée en contact, au
cours des derniers millions d'années, avec tous les composés chimiques
possibles et imaginables que recèle notre planète. Pas juste le produit X qu'un
homéopathe y a dilué.


Pascal Lapointe, rédacteur en
chef de l’Agence Science Presse Montréal (Québec)
http://www.sciencepresse.qc.ca/manchettes.html
7 septembre
Traitement de l’autisme : jugeant les
méthodes psychanalytiques obsolètes
quatre associations de famille saisissent le Comité consultatif
national d'éthique
un article de Jean
Yves NAU, journaliste scientifique au Monde
Quelles sont les
origines exactes de l'autisme et corollaire quelles sont les prises en
charge thérapeutiques les plus adaptées pour venir au mieux en aide aux
personnes souffrant de cette affection hautement handicapante qui touche entre
60 000 et 80 000 personnes en France ?
Cette question fait, depuis plusieurs décennies,
l'objet d'une controverse récurrente. Celle-ci oppose, schématiquement, les
tenants d'une approche psychanalytique à ceux qui postulent que les syndromes
autistiques sont la conséquence de troubles organiques et la résultante
d'anomalies du développement neurologique. Ces derniers temps, la controverse
semblait en voie de perdre de son intensité, des psychanalystes et des
neurobiologistes cherchant à trouver des voies d'approche complémentaires (Le
Monde du 18 mai).
Toutefois, en saisissant de cette question, courant
juillet, le Comité consultatif national d'éthique pour les sciences de la vie
et de la santé (CCNE), les responsables de quatre associations de familles
touchées par cette affection ont choisi de relancer la controverse. "Le but
de cette saisine est d'attirer l'attention du CCNE sur la situation très
préoccupante vécue par les personnes atteintes d'autisme et leur famille en
France", explique Martine Ferguson, présidente
de Fondation Autisme, agir et vaincre, l'une des quatre associations
concernées, avec Pro Aid Autisme, Autisme sans
frontières et Asperger Aide.
Mme Ferguson rappelle que la
France a été condamnée, en mars 2004, par le Conseil de l'Europe à la suite
d'une plainte déposée par plusieurs associations pour non-respect de la Charte
sociale européenne dans la prise en charge des personnes souffrant d'autisme.
"TRAITEMENTS OBSOLÈTES"
"Les traitements des personnes
autistiques par des méthodes de psychiatrie psychanalytique trop souvent
utilisées en France sont obsolètes et abandonnés depuis de nombreuses années,
notamment aux Etats-Unis et dans les pays scandinaves ,
peut-on lire dans le texte de la saisine du CCNE. En revanche, les causes
organiques de l'autisme ont conduit à développer dans ces pays, depuis plus de
40 ans, de nouvelles expériences éducatives et des projets thérapeutiques et
éducatifs intégrant les données de la psychologie cognitive et de l'analyse
comportementale. "
Les associations estiment, en outre, que les méthodes de
thérapies comportementales et cognitives (centrées sur le symptôme) ayant
prouvé leur efficacité et étant préconisées par l'Organisation mondiale de la
santé (OMS) sont trop peu utilisées en France et que les établissements qui y
ont recours sont trop peu nombreux. A ce titre, elles qualifient de
"surprenant" et d'"inadmissible" le fait que Philippe
Douste-Blazy, alors ministre de la santé, ait retiré du site de son ministère
un rapport de l'Inserm affirmant l'efficacité de ces méthodes cognitivo-comportementales et leur supériorité sur les
approches psychodynamiques et psychanalytiques (Le
Monde du 8 février).
"Plusieurs aspects de la prise en charge et des
programmes d'accompagnement proposés aux personnes autistes et à leur famille
ne sont pas en accord avec les valeurs d'éthique dignes de notre pays, estiment
les associations. Bien que l'autisme soit un désordre biologique avec une
origine organique, nous constatons que l'insuffisance
quantitative et qualitative de la formation des professionnels et de la prise
en charge conduisent à mettre dès l'enfance la majorité des personnes autistes
dans des structures incompatibles avec cette population. "
Ils espèrent qu'un avis du CCNE "aidera à changer le
sort des personnes autistes exposées à l'exclusion, contribuera au respect par
la France de ses obligations éducatives à l'égard de ces personnes et
favorisera la création d'institutions éducatives adaptées permettant leur
meilleure intégration dans notre société".
Jean-Yves Nau
![]() Article paru dans
l'édition du 02.08.05
Article paru dans
l'édition du 02.08.05
reproduit sur le
site de l’association Aide Asperger
PRO-CHOICE vs
PRO-LIFE ( pro-choix contre pro-vie)
La souffrance
fœtale au centre de la controverse sur l’avortement aux Etats-Unis
Le Journal of the American Medical
Association plonge dans la
bataille :
Il n’est pas
fondé de parler de souffrance fœtale avant la 30e de semaine de
grossesse
Il est en ce moment en débat aux Etats-Unis d’Amérique qu’une loi fédérale
puisse faire l’obligation aux médecins de donner l’information aux femmes dont
l’intention est d’interrompre leur grossesse à compter de la vingtième semaine
selon laquelle cette interruption engendrerait de la souffrance pour le fœtus.
C’est dans le cadre de cette controverse que le Journal of the American
Medical Association (JAMA vol 294 p 947) publie une étude d’une équipe de l’Université
de Californie, San Francisco, US, conduite par Mark Rosen.
Ainsi, suivant cette étude, on ne saurait parler de souffrance fœtale
avant la 30e de semaine de grossesse, le fœtus ne développant les
connections nécessaires que progressivement de la 23e à la 30e
semaine, et la région du thalamus concernée n’étant pas fonctionnelle avant la
trentième semaine. (Rappels : 1. la durée usuelle moyenne de la
grossesse est de 40 semaines, 2. il ne convient pas de confondre ce qui est du
domaine de la réponse réflexe ou hormonale à des stimuli physiques, et ce qui
est du domaine de la perception voire de la conscience de la souffrance)
Les chercheurs ajoutent d’ailleurs dans le JAMA qu’une anesthésie foetale ou une analgésie ne sauraient être
recommandées ou mises en œuvre de façon routinière dans le cadre de
l’avortement et dans l’état actuel des conditions expérimentales : les
bénéfices qu’en retirerait l’embryon ne sont guère établis alors que les
risques pour la femme peuvent, eux, être augmentés.
Wendy Chavkin,
présidente de l’association des médecins Pro-Choix (Physicians
for Reproductive Choice and
Health PRCH http://www.prch.org/index.html ),
basée à New York City (USA) précise qu’un comité d’experts a statué pendant
deux ans pour aboutir aux mêmes conclusions que l’étude publiée. Selon elle, il
apparaît bien clairement que les lois encadrant les choix reproductifs ont peu
de rapport avec la médecine et la santé mais beaucoup avec la politique et
l’idéologie : «Ce nouvel article du
JAMA illustre une fois de plus que la législation en cette matière ne s’appuie
pas sur des bases médicales ou scientifiques. Ces lois conduiraient les
médecins à fournir à leurs patients des informations imprécises et incorrectes ».
C’est ainsi que pour l’association PRCH l’intention de ce projet de loi est
clair « de stigmatiser l’avortement, les femmes qui ont recours à des
avortements, et les médecins qui les pratiquent ».
Interrogés de leur côté par la BBC, les experts britanniques confirmaient
que les conclusions du JAMA étaient conformes à ce qui était déjà connu en
matière de souffrance fœtale. Le Pr. Charles Rodeck,
professeur de médecine fœtale au University College
London Hospital et porte-parole du Royal College of Obstetricians and Gynaecologists a par ailleurs
précisé qu’au Royaume Uni, pour chaque avortement réalisé au-delà de la
vingt-deuxième semaine, soit une injection est pratiquée pour provoquer l’arrêt
cardiaque du foetus, soit l’intervention est conduite sous anesthésie générale
de la mère (et, par voie de conséquence, du foetus).
Interrogés de leur côté les opposants à
l’avortement, par la voix de Julia Millington, de
l’association UK's Pro Life Alliance, ont
précisé qu’à leur sens « Ce n’est pas la question de savoir si la
victime ressent de la souffrance qui fonde l’opposition à ces meurtres, mais la
violation du plus basique droit individuel humain, le droit à la vie »
![]() http://www.newscientist.com/article.ns?id=dn7900
http://www.newscientist.com/article.ns?id=dn7900
![]() http://news.bbc.co.uk/go/pr/fr/-/2/hi/health/4180592.stm
http://news.bbc.co.uk/go/pr/fr/-/2/hi/health/4180592.stm
Published: 2005/08/24
souvenirs
Communiqué Conjoint OMS/IAEA/UNDP
Tchernobyl : l’ampleur réelle de l’accident
20 ans après, un rapport d’institutions des Nations Unies
donne des
réponses définitives
et propose des
moyens de reconstruire des vies
Jusqu’à 4 000 personnes au total pourraient à terme décéder des
suites d'une radio‑exposition consécutive à
l'accident survenu il y a une vingtaine d'années dans la centrale nucléaire de
Tchernobyl : telles sont les
conclusions d’une équipe internationale de plus d'une centaine de
scientifiques.
Toutefois, à la fin du premier semestre de 2005, moins d'une cinquantaine
de décès avait été attribuée directement à cette
catastrophe. Pratiquement tous étaient des membres des équipes de sauvetage qui
avaient été exposés à des doses très élevées : un grand nombre sont morts dans
les mois qui ont suivi l'accident, mais d'autres ont survécu jusqu’en 2004.
Les nouveaux chiffres sont présentés dans
un rapport abrégé qui fait date intitulé ‘Chernobyl’s Legacy:
Health, Environmental and Socio-Economic Impacts’
(L'héritage de Tchernobyl : impacts sanitaires, environnementaux et socio‑économiques)
que vient de publier le Forum Chernobyl. Basé sur un
rapport de 600 pages en trois volumes, qui regroupe les travaux de centaines de
scientifiques, d'économistes et de spécialistes de la santé, ce rapport abrégé
évalue les conséquences sur 20 ans du plus grave accident nucléaire de
l'histoire. Le Forum est composé de huit institutions spécialisées du système
des Nations Unies, à savoir l'Agence internationale de l'énergie atomique
(AIEA), l'Organisation mondiale de la santé (OMS), le Programme des Nations
Unies pour le développement (PNUD), l’Organisation des Nations Unies pour
l'alimentation et l'agriculture (FAO), le Programme des Nations Unies pour
l’environnement (PNUE), le Bureau de la coordination des affaires humanitaires
(OCHA) de l’ONU, le Comité scientifique des Nations Unies pour l’étude des
effets des rayonnements ionisants (UNSCEAR) et la Banque mondiale, ainsi que
des gouvernements du Bélarus, de la Russie et de
l'Ukraine.
« Cette compilation des recherches les
plus récentes peut contribuer à résoudre les questions que l'on continuait de
se poser sur le nombre de décès et de maladies réellement imputables à
l'accident de Tchernobyl et sur ses répercussions économiques » déclare le
président du Forum Tchernobyl, Burton Bennett, éminent spécialiste des effets
radiologiques. « Les gouvernements des trois pays les plus touchés se sont
rendus compte qu’ils devaient définir clairement la voie à suivre et qu’ils ne
pourraient aller de l'avant qu'en se basant sur un consensus solide quant aux
conséquences environnementales, sanitaires et économiques et en bénéficiant des
conseils judicieux et de l'appui de la communauté internationale. »
« Il s'agit d'un accident très grave ayant
des répercussions sanitaires majeures, notamment pour les milliers de
travailleurs exposés durant les premiers jours qui ont reçu des doses de
rayonnements très élevées et pour les milliers d'autres atteints d'un cancer de
la thyroïde » poursuit M. Bennett. « Toutefois, d'une manière générale, nous
n'avons constaté aucune incidence négative grave sur la santé du reste de la
population des zones avoisinantes, ni de contamination de grande ampleur qui
constituerait toujours une menace sérieuse pour la santé humaine, à l'exception
de quelques rares zones d’accès restreint ».
Le rapport du Forum est destiné à aider
les pays touchés à comprendre l'ampleur véritable des conséquences de
l’accident et à suggérer aux gouvernements du Bélarus,
de la Russie et de l’Ukraine des moyens de résoudre les grands problèmes socio-économiques
qui en découlent. Les membres du Forum, parmi lesquels figurent des
représentants des trois gouvernements en question, se réuniront les 6 et 7
septembre, à Vienne, à l’occasion d’un rassemblement sans précédent de
spécialistes mondiaux de Tchernobyl, des effets radiologiques et de la
radioprotection qui viendront examiner ces conclusions et recommandations.
Principales conclusions du
rapport
Ce rapport volumineux contient des
douzaines de conclusions majeures :
·
Environ un millier de membres du personnel du réacteur qui travaillaient sur le site et de membres des équipes
d’intervention ont été fortement exposés à des doses de rayonnements très élevées le
premier jour de l'accident ; sur les plus de 200 000 de travailleurs affectés à ces
équipes ou chargés d’assurer le retour à la normale en 1986 et 1987, 2 200,
selon les estimations, pourraient décéder des suites d’une radio-exposition.
·
On estime à 5 millions le nombre de
personnes résidant actuellement dans des zones du Bélarus,
de la Russie et de l'Ukraine contaminées par des radionucléides à la suite de
l'accident ; environ 100 000 d'entre elles vivent dans des zones classées
précédemment par les autorités gouvernementales comme zones ‘strictement
contrôlées’. La classification actuelle des zones doit être revue et assouplie
à la lumière des nouvelles conclusions.
·
Quelque 4 000 cas de cancer de la thyroïde, essentiellement chez des enfants et des adolescents au moment de
l'accident, sont imputables à la contamination résultant de l'accident, et au moins neuf enfants en sont
morts ; toutefois, à en juger par l'expérience du Bélarus, le taux de survie parmi les patients atteints de ce type de cancer
atteint presque 99 %.
·
La plupart des membres des équipes d’intervention et des habitants
des zones contaminées ont reçu des doses à l’organisme entier relativement
faibles, comparables aux niveaux du fond naturel de rayonnement. Aucune indication ni probabilité d’une diminution de la
fertilité parmi les populations touchées, ni aucune indication d’une
augmentation des malformations congénitales pouvant être attribuées à une radio-exposition n’a donc pu être établie.
·
La pauvreté, les maladies liées au ‘mode de vie’ qui se
généralisent dans l'ex-Union soviétique, et les troubles mentaux constituent,
pour les populations locales, une menace beaucoup plus grave que l'exposition
aux rayonnements.
·
L’évacuation de quelque 350 000
personnes hors des zones touchées et leur relogement se sont avérés être une
‘expérience extrêmement traumatisante’. Bien que 116 000 d’entre elles aient
été évacuées de la zone la plus gravement touchée immédiatement après
l’accident, les évacuations ultérieures ont joué un rôle négligeable dans la
réduction des radio-expositions.
·
La persistance de mythes et d’idées fausses sur le risque
d'irradiation ont provoqué chez les habitants des
zones touchées un ‘fatalisme paralysant’.
·
Les programmes ambitieux de
réhabilitation et d’avantages sociaux entrepris par l'ex-Union soviétique et
poursuivis par le Bélarus, la Russie et l'Ukraine,
doivent être redéfinis car, outre le fait que la situation radiologique a
changé, ils sont mal ciblés et dotés de ressources insuffisantes.
·
Les éléments structurels du sarcophage construit pour recouvrir
le réacteur endommagé se dégradent et risquent de s'effondrer en provoquant un
rejet de poussière radioactive ;
·
Il reste encore à établir un plan
global pour le stockage définitif des tonnes de déchets hautement radioactifs
sur le site et aux alentours de la centrale de Tchernobyl, qui soit conforme
aux normes de sûreté en vigueur.
Hormis les maladies et les décès radio-induits, le rapport déclare que l'impact de Tchernobyl sur la santé mentale est « le plus grand problème de santé
publique que l'accident ait provoqué » et attribue en partie cet impact psychologique négatif à l’absence
d'informations précises. Les personnes concernées ont une perception négative
de leur état de santé, sont convaincues que leur espérance de vie a été
abrégée, manquent d’initiative et sont dépendantes de l’assistance fournie par
l’État.
« Vingt ans après l'accident de
Tchernobyl, les habitants des zones touchées n'ont toujours pas les
informations dont ils ont besoin pour mener une vie saine et productive qui est
tout à fait possible » explique Louisa Vinton, coordonnatrice pour Tchernobyl au PNUD. « Nous
conseillons aux gouvernements concernés de leur communiquer des informations
précises, non seulement sur les moyens de vivre sans risque dans des régions
faiblement contaminées, mais aussi sur l’adoption de modes de vie sains et la
création de nouveaux moyens de subsistance ». Toutefois, comme le déclare
Michael Repacholi, responsable du programme
Rayonnements de l'OMS « au final, le message du Forum Tchernobyl est rassurant
».
Il explique que sur les 4 000 patients atteints d’un cancer de la thyroïde,
essentiellement des enfants, tous ont guéri, à l'exception de neuf qui sont
décédés. « Ceci mis à part,
l'équipe d’experts internationaux n'a trouvé aucune indication d'une quelconque
augmentation de l’incidence de la leucémie et du cancer chez les habitants
affectés par Tchernobyl ».
Les experts internationaux ont estimé que les rayonnements
pourraient provoquer à terme jusqu'à 4 000 décès chez les populations les plus
exposées après l'accident de Tchernobyl, à savoir les membres des équipes
d’intervention en 1986 et 1987, les personnes évacuées et les résidants de la
plupart des zones contaminées. Ce nombre inclut les décès avérés consécutifs à
des cancers et des leucémies radio‑induits ainsi que des statistiques prévisionnelles basées
sur les estimations des doses de rayonnements reçues par ces populations. Comme
un quart des personnes environ mourront des suites d’un cancer spontané ne
résultant pas de Tchernobyl, il sera difficile d'observer l'augmentation d'environ
3 % seulement induite par les rayonnements. Toutefois, dans les cohortes les
plus exposées des membres des équipes d’intervention et des travailleurs
chargés d’assurer le retour à la normale, on a déjà constaté une augmentation
de certains types de cancer (la leucémie par exemple) à certaines périodes. M. Repacholi a expliqué que les prévisions reposaient sur une
soixantaine d’années d’expérience scientifique des effets de telles doses.
« Les effets sanitaires de l’accident
étaient potentiellement catastrophiques, mais une fois que vous les additionnez
en vous basant sur des conclusions scientifiques dûment validées, en ce qui
concerne le public, ils n’ont pas été aussi forts que ce que l’on pouvait
craindre initialement » conclut M. Repacholi.
L’estimation relative au nombre de décès à terme qui figure dans
le rapport est très inférieure aux hypothèses antérieures largement reprises
par les médias, selon lesquelles les radio-expositions
allaient entraîner la perte de dizaines de milliers de vies humaines.
Cependant, le chiffre de 4 000 n'est pas très éloigné des estimations faites en
1986 par des scientifiques soviétiques, selon Mikhail Balonov,
spécialiste des rayonnements à l'Agence internationale de l'énergie atomique, à
Vienne, qui travaillait dans l'ex-Union soviétique au moment de l'accident.
En ce qui concerne les incidences sur
l'environnement, les rapports des scientifiques sont également rassurants, car
leurs évaluations révèlent qu'à l'exception de la zone fortement contaminée de 30 km de rayon autour
du réacteur, toujours interdite d’accès, de certains lacs fermés et de forêts
d’accès limité, les niveaux de rayonnements sont, pour la plupart, redevenus
acceptables. « Dans la plupart des zones, les problèmes sont économiques et
psychologiques, pas sanitaires ni environnementaux » déclare M. Balonov,
secrétaire scientifique du Forum Tchernobyl qui participe aux initiatives
visant à un retour à la normale depuis la catastrophe.
Recommendations
Le rapport recommande de concentrer les
efforts d'assistance sur les zones fortement contaminées et de redéfinir les
programmes gouvernementaux pour aider ceux qui sont vraiment dans le besoin. Il
est suggéré de substituer aux programmes qui encouragent une ‘dépendance’ et
une mentalité de ‘victime’ des initiatives qui ouvrent des perspectives,
soutiennent le développement local et redonnent aux gens confiance en l’avenir.
Sur le plan de la santé, le rapport du
Forum préconise de continuer à suivre de près les travailleurs ayant souffert
d’un syndrome d'irradiation aiguë et les autres membres des équipes
d’intervention fortement exposés. Il recommande aussi un contrôle ciblé des
enfants traités au radio-iode pour un cancer de la
thyroïde et des travailleurs ayant reçu des doses élevées pendant les
opérations d’assainissement qui sont atteints de cancers non thyroïdiens.
Toutefois, l'efficacité des programmes de contrôle en cours devrait être
évaluée par rapport à leurs coûts, car l'incidence des cancers de la thyroïde
spontanés augmente fortement à mesure que la population cible vieillit. En
outre, l’établissement de registres du cancer très fiables doit bénéficier d'un
appui continu des gouvernements.
En ce qui concerne l'environnement, le
rapport préconise un suivi à long terme des radionucléides du césium et du strontium
pour évaluer l'exposition des êtres humains et la contamination des aliments et
pour analyser l'impact des mesures correctives et des mesures prises pour
réduire la radioactivité. Il faut donner des informations plus complètes au
public sur la présence de substances toujours radioactives dans certains
produits alimentaires et sur les méthodes de préparation des aliments qui
réduisent l’incorporation de radionucléides. Dans certaines régions, des
restrictions à la cueillette de certains produits sauvages sont toujours
nécessaires.
Toujours en ce qui concerne la protection
de l’environnement, le rapport du Forum préconise de mettre en œuvre un
programme de gestion intégrée des déchets provenant du sarcophage, du site de
la centrale de Tchernobyl et de la zone d’exclusion pour que des mesures de
gestion cohérentes puissent être appliquées et que des capacités d’accueil pour
tous les types de déchets radioactifs puissent être créées. Il faut traiter les
problèmes d’entreposage et de stockage définitif des déchets dans toute la zone
d’exclusion de manière globale.
M. Balonov
souligne que dans les zones où l’exposition des êtres humains est faible,
aucune mesure corrective n’est nécessaire. « Si nous ne prévoyons pas
d’incidences sur la santé et l’environnement, nous ne devrions pas gaspiller
nos ressources et nos efforts sur des zones faiblement contaminées qui ne sont
pas prioritaires, mais les concentrer sur les vrais problèmes » ajoute-t-il.
Notant que de larges segments de la
population, particulièrement dans les zones rurales, ne disposent toujours pas
d’informations précises, le rapport insiste en particulier sur la nécessité de
trouver de meilleurs moyens d’informer le public et de surmonter le problème du
manque de crédibilité qui a entravé les initiatives antérieures. Des
informations précises sont disponibles depuis des années, mais soit elles ne
sont pas parvenues aux personnes qui en ont besoin, soit les gens ne les ont
pas crues et acceptées et donc n’en ont pas tenu compte.
Le rapport recommande de cibler les
informations sur des publics précis, notamment les responsables locaux et le
personnel de santé, de définir une stratégie plus large qui encourage des modes
de vie sains et de diffuser des informations sur les moyens de réduire les
expositions internes et externes aux rayonnements et de s’attaquer aux
principales causes de maladie et de mortalité.
Sur le plan socio-économique, il
recommande une nouvelle approche en matière de développement qui aide les
personnes à « prendre en main leur vie et leur environnement pour maîtriser
leur avenir ». Il affirme que les gouvernements doivent rationaliser et
recentrer les programmes relatifs à Tchernobyl en définissant des
indemnisations mieux ciblées, en supprimant celles inutilement accordées aux habitants
des zones les moins contaminées, en améliorant les soins de santé primaires, en
favorisant des techniques sûres de production alimentaire et en encourageant
les investissements et le développement du secteur privé, notamment de petites
et moyennes entreprises.
M. Vinton note
que « le plus important est la nécessité de diffuser des informations précises
sur des modes de vie sains et d’établir des règles plus élaborées pour
promouvoir de petites entreprises en milieu rural. Le vrai danger, c’est la
pauvreté. Nous devons prendre des mesures pour aider les gens à se prendre en
charge ».
Réponse à des questions
restées longtemps en suspens
A quel niveau de rayonnement
les gens ont-ils été exposés à la suite de l’accident ?
À l’exception du personnel sur le site du
réacteur et des membres des équipes d’intervention exposés le 26 avril, la
plupart des travailleurs chargés d’assurer le retour à la normale et ceux qui
vivent dans les zones contaminées ont reçu des doses d’irradiation à
l’organisme entier relativement faibles, comparables aux niveaux du fond
naturel de rayonnement et inférieures aux doses moyennes que reçoivent les gens
qui vivent dans certaines parties du monde où le fond naturel de rayonnement
est élevé.
Pour la majorité des cinq millions
d’habitants des zones contaminées, les expositions se situent dans la limite de
dose recommandée pour le public ; toutefois 100 000 personnes environ reçoivent
encore des doses supérieures. L’assainissement de ces zones et l’application de
contre-mesures agricoles se poursuivent. Les niveaux d’exposition vont
continuer à baisser lentement mais la plus grande partie de l’exposition
résultant de l’accident est advenue.
Combien de gens sont morts et
combien devraient mourir à l’avenir ?
Il y aurait au total quelque 4 000 décès,
parmi les membres des équipes d’intervention et les habitants des zones les
plus contaminées, d’ores et déjà imputables à Tchernobyl ou qui devraient se
produire à l’avenir. Ce chiffre comprend la cinquantaine de membres des équipes
d’intervention décédés des suites du syndrome d’irradiation aiguë, neuf enfants
morts d’un cancer de la thyroïde et 3 940 décès en tout dus à un cancer-radio induit ou à une leucémie parmi les 200 000
membres des équipes d’intervention entre 1986 et 1987, les 116 000 personnes
évacuées et les 270 000 habitants des zones les plus contaminées (soit environ
600 000 personnes au total). Ce sont ces trois grandes cohortes qui ont reçu
des doses de rayonnement supérieures parmi toutes les personnes exposées aux
rayonnements à la suite de l’accident de Tchernobyl.
Selon les estimations, 4 000 décès
supplémentaires pourraient survenir pendant la durée de vie des quelque 600 000
personnes en question. Comme un quart d’entre elles environ mourront des suites
d’un cancer spontané ne résultant pas de l’accident de Tchernobyl, il sera
difficile d’observer l’augmentation d’environ 3 % imputable aux rayonnements.
Toutefois, dans les cohortes les plus exposées des membres des équipes
d’intervention et des travailleurs chargés d’assurer le retour à la normale, on
a constaté une augmentation de certains types de cancer (la leucémie par
exemple).
La confusion qui existe quant à l’impact
de l’accident vient du fait que des milliers d’habitants des zones touchées
sont décédés de mort naturelle. En outre, du fait que la population locale
s’attend généralement à avoir un bilan de santé mauvais et qu’elle a tendance à
mettre tous les problèmes de santé sur le compte de l’exposition aux
rayonnements, elle a supposé que les décès imputables à l’accident de
Tchernobyl étaient beaucoup plus nombreux qu’ils ne le sont réellement.
Quelles maladies se sont déjà
déclarées ou risquent de se déclarer à l’avenir ?
Les habitants qui ont consommé des denrées
contaminées à l’iode radioactif dans les jours qui ont suivi immédiatement
l’accident ont reçu des doses à la thyroïde relativement élevées. Ceci est tout
particulièrement vrai des enfants qui ont bu du lait de vaches qui avaient
mangé de l’herbe contaminée. Le fait que l’iode se concentre dans la thyroïde
explique dans une large mesure l’incidence élevée du cancer de la thyroïde chez
les enfants.
Plusieurs études récentes font état d’une
légère augmentation de l’incidence de la leucémie chez les membres des équipes
d’intervention mais pas chez les enfants ni chez les adultes qui vivaient dans
les zones contaminées. Une faible augmentation des cancers solides et peut-être
de maladies du système circulatoire a été relevée mais doit être évaluée plus
en détail en raison de l’influence indirecte possible de facteurs tels que le
tabac, l’alcool, le stress et un mode de vie malsain.
Y a-t-il ou y aura-t-il des
effets héréditaires ou des effets sur les organes reproducteurs?
En raison des doses relativement faibles
reçues par les habitants des zones contaminées, aucune indication ni
probabilité d’une diminution de la fertilité n’a pu être établie ni chez les
hommes ni chez les femmes. Par ailleurs, les doses étant si faibles, il a été
impossible d’établir la preuve de quelconques effets sur le nombre d’enfants morts-nés, de grossesses non menées à terme, de
complications à l’accouchement ou sur l’état de santé général des enfants. Il
semble que l’augmentation modeste mais régulière des malformations congénitales
signalées tant dans les zones contaminées que dans les zones non contaminées du
Bélarus soit liée à une amélioration de la qualité
des rapports établis sur la question et non aux rayonnements.
Est-ce que le traumatisme d’un
relogement rapide a provoqué des troubles psychologiques ou mentaux persistants
?
Des symptômes de stress, de dépression,
d’anxiété et autres symptômes physiques médicalement inexpliqués, y compris le
sentiment d’être en mauvaise santé, ont été signalés. Le fait que les personnes
touchées aient été désignées comme des ‘victimes’ et non comme des ‘survivants’
les a conduites à se considérer elles-mêmes comme des êtres sans défense,
faibles et ne maîtrisant pas leur avenir. Cela a suscité chez elles des
comportements timorés et une inquiétude exagérée quant à leur santé soit, au
contraire, des réactions totalement irresponsables se manifestant par la
consommation de champignons, de baies et de gibier provenant des zones toujours
classées comme hautement contaminées, par l’abus d’alcool et de tabac et par le
vagabondage sexuel non protégé.
Quelles ont été les incidences
sur l’environnement ?
Les écosystèmes touchés par Tchernobyl ont
été largement étudiés et surveillés ces 20 dernières années. Pendant dix jours
après l’accident, des rejets importants de radionucléides ont eu lieu,
contaminant plus de 200 000 km² en Europe. L’ampleur du dépôt de radioactivité
a varié suivant qu’il pleuvait ou non lors du passage des masses d’air
contaminées.
La plupart des isotopes de strontium et de
plutonium ont été déposés dans un rayon de 100 km autour du réacteur endommagé.
L’iode radioactif était une source d’inquiétude majeure après l’accident mais,
comme il a une période courte, il a complètement décru à présent. Le strontium
et le césium, qui ont une période plus longue de 30 ans, sont toujours actifs
et resteront une source de préoccupation pendant encore des dizaines d’années.
Bien que les isotopes de plutonium et l’américium 241 restent radio-actifs pendant peut-être des milliers d’années, leur
contribution à l’exposition humaine est faible.
Quelle est l’ampleur de la
contamination urbaine ?
Les surfaces à l’air libre, comme les
routes, les espaces verts et les toits, ont été les plus contaminées. Les
habitants de Pripyat, la ville la plus proche de
Tchernobyl, ont été rapidement évacués, ce qui a permis de réduire leur
exposition éventuelle à des matières radioactives. Le vent, la pluie et
l’activité humaine ont réduit la contamination de surface mais ont entraîné une
contamination secondaire des systèmes d’égouts et de boues d’épuration. Le
niveau de rayonnement dans l’air au‑dessus des zones habitées est revenu
au niveau du fond naturel mais il est resté plus élevé au-dessus des sols nus.
Quel a été le degré de
contamination des zones agricoles ?
Les intempéries, la décroissance physique,
la migration des radionucléides dans le sol et les baisses de biodisponibilité
ont entraîné une réduction sensible du transfert des radionucléides aux plantes
et aux animaux. Du fait de son absorption rapide dans le lait à partir de l’herbe
et des fourrages, l’iode radioactif a suscité des préoccupations au début et
des niveaux élevés ont été signalés dans certaines parties de l’ex-Union
soviétique et du sud de l’Europe mais, étant donné la période courte de ce
nucléide, les craintes se sont vite apaisées. À l’heure actuelle et sur le long
terme, le radiocésium, présent dans le lait, la
viande et certains végétaux, reste le plus grand sujet de préoccupation pour
l’exposition humaine interne mais, à l’exception de quelques rares zones, les concentrations
se situent en deçà des niveaux sûrs.
Quelle est l’ampleur de la
contamination forestière ?
Après l’accident, les animaux et la
végétation dans les zones de forêt et de montagne ont absorbé une forte
quantité de radiocésium, les niveaux d’activité
restant longtemps élevés dans les champignons, les baies et le gibier.
L’exposition provenant des produits agricoles ayant baissé, l’impact relatif de
l’exposition provenant des produits forestiers a augmenté et ne diminuera
qu’avec la migration dans le sol et la décroissance lente des matières
radioactives. Un transfert élevé de radiocésium du
lichen à la viande de renne et aux humains a été observé dans la région
arctique et sub-arctique, la viande de renne étant fortement contaminée en
Finlande, en Norvège, en Russie et en Suède. Les gouvernements concernés ont
imposé des restrictions à la chasse, notamment en programmant l’ouverture de la
saison de chasse à la période où la chair des animaux est moins contaminée.
Quelle est l’ampleur de la
contamination dans les systèmes aquatiques ?
La contamination des eaux de surface à
travers la plupart de l’Europe a baissé rapidement grâce à la dilution, à la
décroissance physique, et à l’absorption de radionucléides dans les sédiments
du fond et dans les sols des bassins versants. Toutefois, en raison de la bio-accumulation dans la chaîne alimentaire aquatique, on a
trouvé des concentrations élevées de radiocésium dans
des poissons provenant de lacs aussi éloignés que ceux d’Allemagne et de
Scandinavie. Les niveaux comparables de radiostrontium,
élément qui se concentre dans les arêtes et non dans les muscles, n’ont pas été
significatifs pour les humains. Les niveaux dans le poisson et les eaux sont
actuellement bas, sauf dans les zones où se trouvent des lacs ‘fermés’ sans
déversoir. Dans ces lacs, les niveaux de radiocésium
contenu dans le poisson resteront élevés pendant des décennies et les
restrictions imposées à la pêche devraient donc y être maintenues.
Quelles contre-mesures
environnementales et autres mesures correctives ont été prises ?
La contre-mesure agricole la plus efficace
prise dès le début a été de retirer de l’alimentation animale l’herbe des
pâturages contaminés et de surveiller les niveaux de rayonnement dans le lait.
Le traitement des terres pour les cultures fourragères, les fourrages ‘propres’
et l’emploi de liants de césium (qui empêchent le transfert de radiocésium des fourrages au lait) ont permis de réduire
considérablement la contamination et de continuer à pratiquer l’agriculture,
encore qu’un accroissement de la teneur en radionucléides des produits végétaux
et animaux ait été mesuré depuis le milieu des années 90, lorsque les problèmes
économiques ont obligé à réduire les traitements. L’utilisation de certaines
terres agricoles dans les trois pays concernés est interdite tant que des
mesures correctives n’auront pas été prises.
Un certain nombre de mesures appliquées
aux forêts dans les pays touchés et en Scandinavie ont permis de réduire
l’exposition des êtres humains, notamment les restrictions imposées à l’accès à
certaines zones de forêts, à la récolte de produits comestibles comme le
gibier, les baies et les champignons et au ramassage public de bois de
chauffage, parallèlement aux nouvelles mesures prises au niveau de la chasse pour
éviter la consommation de viande de gibier lorsque les niveaux saisonniers de radiocésium risquent d’être élevés. Les faibles niveaux de
revenus dans certaines régions poussent la population locale à ignorer ces
règles.
Quels ont été les effets radio-induits sur les plantes et les animaux ?
On a constaté un accroissement de la
mortalité des conifères, des invertébrés et des mammifères et une perte de la
capacité de reproduction végétale et animale dans les zones à forte exposition sur
un rayon de 20 à 30 kilomètres. Au-delà de cette zone, aucun effet radio-induit aigu n’a été signalé. La réduction des niveaux
d’exposition a permis aux populations biologiques de se rétablir, bien que l’on
ait constaté des effets génétiques des rayonnements dans les cellules
somatiques et germinales de plantes et d’animaux. L’interdiction d’activités
agricoles et industrielles dans la zone d’exclusion a permis à de nombreuses
populations végétales et animales de se propager et a créé paradoxalement un ‘sanctuaire
unique de biodiversité’.
Est-ce que le démantèlement du
sarcophage et la gestion des déchets radioactifs posent de nouveaux problèmes
environnementaux ?
Le sarcophage protecteur a été érigé très
vite, ce qui explique certaines imperfections de la structure elle-même et n’a
pas permis de rassembler toutes les données sur la stabilité de la tranche du
réacteur endommagée. En outre, certains éléments structurels du sarcophage se
sont corrodés en 20 ans. Le principal danger que pourrait présenter le
sarcophage est l’effondrement de ses structures supérieures qui entraînerait un
rejet de poussière radioactive.
Ces structures instables ont été
renforcées récemment et la construction d’une nouvelle enveloppe de confinement
sûre destinée à recouvrir le sarcophage actuel va démarrer bientôt. Cette
enveloppe, conçue pour tenir plus d’un siècle, permettra le démantèlement du
sarcophage actuel, l’enlèvement de la masse de combustible radioactif de la
tranche endommagée et, à terme, le déclassement du réacteur endommagé.
Il reste à définir une stratégie globale
pour la gestion des déchets de haute activité et de longue période qui
proviennent d’anciennes activités de dépollution. Une grande quantité de ces
déchets a été entreposée provisoirement dans des tranchées et des décharges qui
ne répondent pas aux prescriptions en vigueur en matière de sûreté des déchets.
Quel a été le coût économique ?
En raison des politiques appliquées à
l’époque de l’explosion et compte tenu de l’inflation et des bouleversements
économiques qui ont suivi l’éclatement de l’Union soviétique, il n’a pas été
possible de calculer les coûts exacts. Une série d’estimations effectuées dans
les années 90 ont chiffré les coûts étalés sur 20 ans à des centaines de
milliards de dollars. Ces coûts couvrent les dégâts directs, les dépenses liées
à la remise en état et à l’atténuation des effets, le relogement des gens, la
protection sociale et les soins de santé de la population touchée, la recherche
sur l’environnement, sur la santé et sur la production d’aliments ‘propres’, la
surveillance radiologique ainsi que les pertes indirectes dues à l’interdiction
de l’utilisation de terres agricoles et de forêts et à la fermeture
d’installations agricoles et industrielles, mais aussi des coûts additionnels
comme l’annulation du programme électronucléaire bélarussien
et le surcoût énergétique occasionné par la perte de production d’électricité
en provenance de Tchernobyl. Les coûts ont lourdement grevé les budgets des
trois pays concernés.
Quelles ont été les principales
conséquences pour l’économie locale ?
L’agriculture a été le secteur le plus
durement touché, 784 320 hectares de terres ayant été interdits à la production
agricole. La production de bois a été interrompue sur 694 200 hectares de
forêt. Des mesures correctives ont permis de produire des aliments ‘propres’
dans de nombreuses régions mais ont entraîné une augmentation des coûts
imputable à l’emploi d’engrais, d’additifs et de procédés de culture spéciaux.
Même là où l’agriculture et l’élevage sont sans risque, la connotation négative
que revêt le nom de Tchernobyl a posé des problèmes de marketing et a entraîné
une chute des revenus, une baisse de la production et la fermeture
d’installations. Parallèlement, les bouleversements dus à l’effondrement de
l’Union soviétique, à la récession et aux nouveaux mécanismes de marché ont nui
à l’économie de la région et se sont traduits par une baisse du niveau de vie,
le chômage et une pauvreté accrue. Toutes les régions agricoles, quelles aient
été touchées par les rejets radioactifs ou non, se sont avérées vulnérables.
La pauvreté est particulièrement aiguë
dans les zones touchées. Les salaires des ouvriers agricoles sont généralement
bas et les emplois en dehors de l’agriculture sont limités. Un grand nombre
d’ouvriers qualifiés et diplômés, surtout des jeunes, ont quitté la région. Qui
plus est, le climat des affaires n’est pas propice à la création d’entreprises
et l’investissement privé est modeste.
Quel impact Tchernobyl et l’après-Tchernobyl ont-ils eu sur les communautés locales ?
Plus de 350 000 personnes ont été relogées
en dehors des zones les plus contaminées, dont 116 000 immédiatement après
l’accident. Même après avoir eu des indemnisations, un logement gratuit et le
choix de leur nouveau domicile, l’expérience a été traumatisante pour un grand
nombre des personnes évacuées, qui se sont retrouvées sans travail et qui ont
le sentiment de ne plus avoir de place dans la société. Les enquêtes montrent
que ceux qui sont restés ou qui sont retournés chez eux vivaient mieux l’après-Tchernobyl que ceux qui ont été relogés. Les tensions
entre les nouveaux arrivés et la population d’origine dans les villages de
relogement ont aussi contribué à l’ostracisme ressenti par les premiers. La
structure démographique des zones touchées s’est dégradée car beaucoup
d’ouvriers qualifiés, diplômés et ayant l’esprit d’entreprise, souvent des
jeunes, ont quitté la région en laissant derrière eux une population âgée qui
ne possède guère les qualités requises pour remettre l’économie en route.
Étant donné le vieillissement de la
population, il y a plus de décès que de naissances, ce qui renforce le
sentiment que ces zones sont des endroits dangereux. Même lorsque les salaires
y sont élevés, les écoles, les hôpitaux et les autres services publics de base
manquent de spécialistes qualifiés.
Quelles ont été les incidences
sur les individus ?
D’après le rapport du Forum sur la santé,
l’impact de Tchernobyl sur la santé mentale est le plus grand problème de santé
publique que l’accident ait provoqué à ce jour. Les habitants des zones
touchées ont une perception négative de leur état de santé et de leur
situation, exacerbée par un sens exagéré du risque sanitaire que la radio‑exposition leur fait courir et par la
conviction que leur espérance de vie est réduite. Rien n’indique que l’anxiété
concernant les effets sanitaires des rayonnements est en train de diminuer, au
contraire. L’espérance de vie est en baisse dans toute L’ex-Union soviétique à
cause des maladies cardiovasculaires, des blessures et des empoisonnements,
mais pas à cause des maladies radio‑induites.
Comment les gouvernements
ont-ils réagi ?
Les programmes de relogement et de
réhabilitation lancés à l’époque de l’Union soviétique n’ont pas pu être
maintenus après 1991 et le financement de projets a diminué, de sorte que de
nombreux projets n’ont pas pu être achevés ou ont dû être abandonnés et qu’un
grand nombre des prestations promises ont manqué de financement. En outre, des
indemnisations ont été allouées à des catégories très larges de ‘victimes de
Tchernobyl’, finissant par couvrir jusqu’à sept millions de personnes qui
reçoivent déjà ou qui peuvent prétendre à recevoir des retraites, des primes
spéciales et des prestations maladie, y compris des vacances gratuites et des
indemnités garanties. Les prestations accordées aux victimes de Tchernobyl
privent de ressources d’autres secteurs des dépenses publiques, mais une
réduction de ces indemnisations ou un ciblage limité aux groupes à haut risque
est impopulaire et pose des problèmes politiques.
Vu la réduction notable des niveaux de
rayonnement au cours des 20 dernières années, les gouvernements doivent revoir
la classification des zones contaminées. De nombreuses zones considérées
auparavant comme zones à risque sont en fait propres à l’habitation et à la
mise en culture. Les classifications actuelles sont beaucoup plus restrictives
que ne le justifient les niveaux de rayonnement démontrés.
Le rapport souligne la nécessité d’affiner
les priorités et de rationaliser les programmes pour atteindre ceux qui sont le
plus dans le besoin, tout en rappelant qu’une réallocation des ressources
risque de susciter une ‘vive résistance de la part de ceux qui en bénéficient
déjà’. Il est suggéré entre autres que le droit à des indemnisations soit
‘racheté’ en échange d’une somme forfaitaire destinée à financer le démarrage
de petites entreprises.
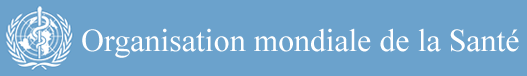
http://www.who.int/mediacentre/news/releases/2005/pr38/fr/
forum du nouvel observateur



10 mai
2005
Louis-Marie
HOUDEBINE, directeur de recherches de
l’INRA
membre du comité scientifique de l’AFIS,
est invité sur le forum internet du
Nouvel Observateur
pour dialoguer avec les internautes de
la questions des OGM
http://www.nouvelobs.com/forum/archives/forum_307.html
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||


